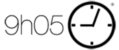La tristesse comme vecteur de fête chez les Équatoriens
Des accords de guitare retentissent soudain, puis les trompettes font leur apparition. Une légère clameur gagne le public. Dans le fond de la scène, une voix entonne « tablas duras me llevo / cuatro tablas bien lisas / mi cuerpo vacío hermano / a la tumba me voy » et le délire s’installe durablement dans la foule qui se met à gigoter au rythme allègre de cette musique populaire, véritable hymne à la culture équatorienne.
Cet exemple, vécu en chair et en os, nous vient des fêtes de Quito de 2015, qui célèbrent chaque année l’anniversaire de la fondation de la capitale de l’Équateur, la Carita de Dios, Luz de América comme on la surnomme, le 6 décembre 1534.
Il peut directement être mis en relation avec ce que Jorgenrique Adoum aborde dans Ecuador : señas particulares, au chapitre sur les célébrations équatoriennes, « La tristeza de la alegría popular », la tristesse comme vecteur de fête chez les Équatoriens, et tout particulièrement dans les Andes de ce pays latino-américain.
Jorgenrique Adoum est un poète, romancier et traducteur Équatorien né à Ambato, au cœur des Andes, en 1926, et mort à Quito en 2009. Auteur culte en Équateur, il continue d’imprégner de sa patte la littérature telle qu’elle se produit aujourd’hui. Sa facette d’essayiste reste moins connue mais n’est pas dénuée d’intérêt.
Dans l’essai que nous mentionnerons aujourd’hui, Ecuador: señas particulares, Adoum dresse le portrait sans ambages de la société équatorienne comme il la voit, dans toutes ses contradictions.
Et comme l’objet de ce colloque d’équipe est la fête et que mon travail de recherche est axé sur Jorgenrique Adoum, la créativité et l’équatorianité, il m’est apparu naturel de me pencher sur le chapitre intitulé « La tristeza de la alegría popular ».
Les considérations que notre auteur équatorien dresse dans son essai sont à rapprocher de prime abord avec ce qu’Alexander Von Humboldt, géographe, naturaliste et explorateur Prussien écrivait en 1826 à propos de sa visite en Équateur :
Los ecuatorianos son seres raros y únicos: duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste.
Cette observation vieille de deux siècles reste d’actualité aujourd’hui encore. Je me souviens moi-même de nombreuses célébrations (mariages, baptêmes et autres fêtes de quartier) où les participants entonnaient en hurlant, les larmes aux yeux, le rythme dans les hanches, le verre levé, les paroles de chansons d’amours éconduites et de despecho :
En vida que me quisieras / de muerto ya para qué / ahí todo se ha de quedar / Si acaso me llegue el destino / de partir ya de este mundo / a nadie molestaré / a nadie invitaré / ahí todo se ha de quedar
Et ce qu’il y a dans ces chansons, ce n’est pas l’espoir de dépasser et de surmonter la perte amoureuse, sinon le désespoir total et l’apitoiement. Et c’est cet apitoiement qui se fait vecteur de fête. Adoum parle d’une société culturellement déprimée dans sa critique à l’endroit de l’idiosyncrasie équatorienne, origine qu’il impute aux missions d’évangélisation des peuples autochtones, et dont les effets auraient été étendus à toutes les classes et toutes les zones géographiques du futur pays par le pouvoir espagnol afin d’asseoir son autorité.
Le pessimisme ambiant qui teinte les rapports quotidiens en Équateur est doublement actualisé par exemple dans le pasillo Adiós (despedida) de Carlos Solís Morán :
Por tu culpa y por mi mala suerte / vengo a darte la eterna despedida / pues siento que las olas de la muerte / se bañan en las playas de mi vida
On l’aura compris, la fête est souvent le symbole d’un profond désespoir en Équateur. Est-ce l’occasion d’oublier sa tristesse ? Pas forcément, on l’a vu, les vers des chansons les plus populaires, du yaraví au pasillo en passant par le san juanito, sont aussi les plus tristes.
À ce propos, Adoum nous dit : « La culpa de lo que nos sucede la tiene siempre alguien: el presidente, el director, el árbitro, mi general, la dueña de casa, el mecánico… y nosotros, como subalternos sin criterio sujetos a la « obediencia debida », no reconocemos responsabilidad alguna en la administración de nuestra mala suerte. »
Si la faute du malheur ressenti incombe à l’autre, le sentiment équatorien lui associe également ceci, de l’avis de Joaquín Gallegos Lara dans Las cruces sobre el agua qui relate le massacre des ouvriers du 15 novembre 1922 à Guayaquil : « [Ecuador es] un país donde toda felicidad que tenemos se la quitamos a alguien y donde aspirar a ser feliz es una canallada ».
Aussi, la fête est le lieu du désespoir, on y étanche ses peines par la danse mais aussi la boisson. Adoum rapporte les propos de Miguel Ángel Asturias, qui indique que « Allí beben, como si al día siguiente no fuera a haber más días ». Preuve en sont les corps comateux qui jonchent les trottoirs les lendemains des célébrations des fiestas de Quito dans les quartiers de la ville.
Jorgenrique Adoum dédie ainsi à la phase d’après-fête un poème appelé Americanismos, hymne par antonomase au fêtard équatorien et par extension latino-américain :
Americanismos
como si aquello también no hubiera sido
sino cuestión de tragos
espartáquicos proyectos de heroísmo
incitaciones de la mar océano
la obra misteria que no se había escrito
y despertáramos a fórceps o a tirones
con una espantosa resaca para siempre
llámase perseguidora guayabo cruda
goma ratón chuchaque cuerpomalo
según el país donde nos subdesarrollan mucho
(en los otros gueule de bois o hangover)
Llámase la vida para ser más claros
Expression populaire de la tristesse donc, la fête sert aussi de lieu fédérateur. C’est le cas par exemple des hornados solidarios, fêtes à l’initiative de vecinos qui font face à une situation financière difficile (pour payer une opération chirurgicale complexe et des frais de santé exorbitants, payer des frais d’accident, trouver de l’argent pour payer un enterrement…).
Moyennant un bon pour un plat d’hornado de chancho con papas y mote y trago (porc enfourné entier aux pommes de terre et au maïs), on peut y danser de sol a sol, boire, se mettre triste et pleurer de joie à l’écoute de yaravíes comme celui-ci :
Mi vida es cual hoja seca que va rodando por el mundo / no tiene ningún consuelo / no tiene ningún halago / por eso cuando me quejo mi alma padece cantando / mi alma se alegra llorando
Adoum abonde dans ce sens : « Y entre el alcohol y el pasillo, entre el recuerdo y la desesperanza y la maldita « mala suerte » de la que somos siempre víctimas, pese a ser « muy hombres » no ocultamos las lágrimas. Descripción y no chiste es la que alguien hacía de la fiesta de la víspera : « Pasamos lindo. ¡Lloraaamos! ». Je peux vous confirmer pour l’avoir entendu moi-même à tant de reprises que c’est un classique des lendemains de fête.
La fête équatorienne, on l’aura compris, c’est le lieu de la débauche : débauche de tristesse, débauche de sentiments contradictoires, débauche de trago. Comme le chante Gerardo Morán, interprète de chicha équatorienne :
Cómo mato este dolor, con una copa de vino, una botella de ron / Cómo seco mis lágrimas si mi fiel cigarro sabe la verdad
La débauche sera d’ailleurs traduite en équatorien par desmadre, dans une réactualisation étymologique qui est une variante construite par préfixation privative de madre, la privation de la mère donc, ou encore la sacadera de madre, sacadera de aire, sacadera de jugo, sacadera de puzún, sacadera de puta, tous synonymes à des degrés divers, qui expriment un même fait, celui de s’être dépensé au point d’être figurativement privé de mère, privé d’essence, privé d’air, privé de ses tripes.
Ce besoin de la tristesse comme vecteur de fête est aussi une constante dans la littérature équatorienne actuelle.
Dans son roman Fiebre de carnaval paru en 2022 aux éditions La Navaja, l’Équatorienne de la costa Yuliana Ortiz Ruano fait de la musique une métaphore filée de l’état d’esprit de sa protagoniste. On y voit une petite fille en détresse qui parvient à une sorte de salut par la musique et malgré la musique, par les chansons tristes aux rythmes tropicaux joyeux.
Santiago Vizcaíno, autre auteur Équatorien, dresse le portrait d’un personnage Équatorien qui vit à Malaga et qui, de son point de vue, à la fois tendre et grotesque, décrit paysages, portraits et scènes qui pourraient appartenir à un film de losers et de cyniques, mais qui n’est autre qu’un instantané de la réalité. Cette réalité, celle qui nous déplait, celle qui prend ses distances avec les grandes histoires et la grande vie.
Ce roman Complejo, traduit par mes soins aux éditions Elytis, matérialise le comportement de l’Équatorien émigré :
fuimos a una discoteca al sur de madrid. era domingo. no lo podía creer. en quito los domingos dan ganas de matarse. no encuentras nada abierto. la gente huye. pero aquí es el día en que el migrante sale de marcha, porque muchos tienen el lunes libre, día bendito de resaca, de chuchaqui, de guayabo, de ratón, de cruda.
Peut-on voir dans cet apparent paradoxe de la tristesse comme moteur de célébration une expression de l’inquiétante étrangeté chère à Sigmund Freud ? Federico Bravo saura peut-être répondre à cette énigme, toujours est-il qu’en Équateur, les contradictions se suivent mais ne se ressemblent pas.
Pour finir, impossible de faire l’impasse sur l’un des pasillos les plus chantés dans les karaokés de la chaîne « Para cortarse las venas », dont le nom est évocateur : Ódiame de Julio Jaramillo.
Liens vers les chansons
–https://www.youtube.com/watch?v=efow1aP_bEk
–https://www.youtube.com/watch?v=2oZjN8RFUlE
–https://www.youtube.com/watch?v=E8tkKN36rb4
–https://www.youtube.com/watch?v=ZE7NIP3Kv6o
–https://www.youtube.com/watch?v=eIt_RjdRe7w
–https://www.youtube.com/watch?v=ft1A0ksoV6Q