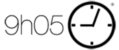Gabriela Aleman, La mort fredonne un blues
Elle était affalée sur le lit, n’ayant pas la moindre intention de se lever, quand elle se souvint des lignes. La veille au soir, elle avait tracé une ligne diagonale sur les quatre lignes verticales, à côté, il y en avait cinq autres ; elle les avait tracées sur le mur, comme on compte les jours en prison. Elle se leva, se dirigea vers l’armoire puis s’habilla. Quand elle sortit, vers neuf heures du matin, le bleu du ciel affichait la couleur d’une flamme de gaz. Elle marcha vers le bureau de poste et, arrivant à sa boite postale, la voyant vide, elle sut qu’elle devait renoncer. Tout ce dont elle se souvenait de son visage était trouble et, malgré cela, cela faisait des mois qu’elle allait tous les onze jours chercher une lettre qui jamais n’arrivait. Si elle faisait l’addition des mois passés, cela faisait des années. Bien sûr qu’elle le savait, elle savait bien que c’était inutile : la seule chose qu’elle se rappelait vraiment était la mélodie qu’il avait l’habitude de fredonner. Une musique crue que n’importe quel vautour aurait dévoré aussitôt. […]
Elking Araujo, L’ingratitude de Chronos
Trente-trois horlogers travaillaient huit heures par jour au sous-sol d’un ministère à démonter des montres et à mettre le temps dans de petits sacs en plastique. Il y avait trente-trois bureaux séparés de l’obscurité générale par le cercle de lumière des lampes, et à côté d’eux, trente-trois grands sacs remplis de montres mécaniques. Les hommes, cyclopes à monocle, retiraient une pièce après l’autre, une vis après l’autre, et triaient les couvercles, verres, ancres, ressorts, aiguilles, fils métalliques et protections jusqu’à atteindre le cœur de la machine où, caché comme dans un automne en retard, le temps faisait son nid. Ils l’extrayaient avec une cuillère minuscule et le mettaient dans des sacs. Ils les fermaient, les étiquetaient et les rangeaient dans un tiroir de leur bureau avec d’autres sacs qu’on retirait le soir et qu’on emballait dans des cartons. Dans les étages supérieurs du ministère, la bureaucratie suivait son cours, imperturbable par ces trente-trois hommes qui pointaient leur arrivée à huit heures chaque matin, apportant leur petite caisse à outils, et qui ne réapparaissaient qu’à midi, vêtus de leurs salopettes de menuisiers, pour manger un sandwich dans le patio autour du bassin central. Ils ne se laissaient faire par personne, ils étaient revêches, distants et vieux. […]
Edgar Allan Garcia, Le serpent à sept têtes
Quand il était allé voir, pour la première fois, son oncle Romualdo, il s’était senti tout intimidé. Sa maman lui avait dit que son oncle était un homme grand et costaud, et qu’il avait les bras cramés par le soleil tropical. Coiffé d’un chapeau de paille et de bottes en caoutchouc qui montaient presque jusqu’à ses genoux imprégnés de boue séchée, son oncle le salua en l’enlaçant jusqu’à l’étouffer mais lui, l’espace d’un instant, il aurait voulu se diriger vers sa maman pour lui dire qu’il ne voulait plus rester là, et qu’il préférait rentrer à Quito, mais cela aurait été une réaction d’enfant mais il avait onze ans maintenant, alors il ne bougea pas d’un pouce et respira profondément. Comme si elle avait vu ce qui se passait dans sa tête, sa maman posa sa main sur son épaule et lui dit : mon fils, voici ton oncle Romualdo dont je t’ai parlé, tu vas voir comme tu vas t’amuser avec mon frère et tes cousins. Il lui sourit, nerveux, et se laissa porter par la main de son oncle. […]
Monica Ojeda, Mâchoire
À peine eut-elle ouvert les yeux que les ombres du jour se brisant s’affaissaient sur elle. C’étaient de volumineuses taches — « l’opacité est l’esprit des objets » disait son psychanalyste — qui lui permettaient de deviner quelques meubles mal en point et, plus loin, un corps fantasmagorique récurant le sol avec une serpillière pour hobbits. « Merde », cracha-t-elle contre le bois sur lequel s’écrasait le côté le plus laid de son visage de Twiggy-face-of-1966. « Merde », et sa voix résonna comme celle d’un dessin animé en noir et blanc un samedi soir. Elle se voyait en imagination où elle était, sur le sol, avec le visage de Twiggy, qui était en réalité le sien sauf pour ce qui est de la couleur-canard-classique des sourcils de la mannequin anglaise ; sourcils-canard-de-baignoire qui ne ressemblaient en rien à la paille brûlée et non épilée autour de ses yeux. Même si elle ne pouvait pas se voir, elle savait exactement la forme reproduite par son corps gisant et l’expression peu gracile qu’elle devait avoir dans cet infime instant de lucidité. Cette conscience complète de son image lui procura une sensation de contrôle, sans la rassurer totalement car, malheureusement, la connaissance de soi n’avait jamais transformé personne en Wonder Woman, qui était précisément ce qu’elle devait devenir pour se libérer des cordes qui lui liaient les mains et les jambes, comme les actrices les plus glamours de ses thrillers préférés. […]
Aleyda Quevedo, Je suis mon corps
À Quito je dois me faire
Maintenant que je veux changer de ville
et ne plus jamais revoir ces montagnes
ni la violence du vent des hauteurs
Maintenant que ni même ses splendides églises
ni le bleu du ciel
ni la lumière limpide qui entoure les nuages
ne me plaisent plus
Pas même les rues de pierre
ou la vierge protectrice
ni les proches vallées
ou le Machángara à la menthe
Rien ne m’émeut plus désormais ni me retient dans cette ville
C’est maintenant justement que je comprends que je suis condamnée
à vivre à Quito
En y éprouvant le manque d’oxygène
Et les regards inquisiteurs qui y ont survécu C’est ce à quoi
je dois me faire
et je vis graciée par cette condamnation
que j’ai toujours poursuivie
que je ne me résous pas à oublier ni à accepter
Sans doute si la mer était du côté du Parc Métropolitain
tout serait plus simple pour moi
Des montagnes gigantesques
Qui encerclent mon cœur
Et les nuages qui grandissent tels des monstres blancs
par-dessus ma petite tête
Maintenant que je ressens le besoin de changer de ville
je vois bien que personne ne décide où il vit
C’est Quito qui m’a choisie
Je le sais.
Abdon Ubidia, Train de nuit
Elle entendit un profond sifflement suivi du vacarme d’un train s’approchant à grande allure. Silencieuse, tremblante, les yeux ouverts dans l’obscurité, elle imaginait les pistons et les barres s’entrechoquant, les nuages de vapeur qui échappaient furieusement au milieu de la rouille des roues et des rails salis de boue et de graisse, ce flux d’acier reposant sur de l’acier. Mais c’était bien absurde, la gare ferroviaire se situait à l’autre bout de la ville. Il était impossible d’entendre quoi que ce soit qui s’y passait. Il est bien vrai que l’insomnie aiguise les sens, les prolonge, les électrise, les rend capables de capter des signaux, des détails demeurant occultes le jour, noyés dans les images impétueuses de l’agitation urbaine. On peut entendre le grincement régulier du bois qui travaille dans l’armoire. Ou les rongements d’un petit animal creusant des tunnels et des galeries dans la chaux et les briques des murs de la chambre. Ou les insectes qui s’écrasent contre le verre des fenêtres. Ou sa propre respiration. Ou, plus loin, la rumeur de la ville endormie —un grondement lointain, une somme de murmures inquiétants, d’automobiles éloignés qui fuient, de hurlements isolés, d’échos de fabriques au loin, de pas solitaires, de sifflements des veilleurs de nuit, de cris probables, de chansons probables s’échappant des bars ouverts au petit matin—. Mais la gare ferroviaire se trouvait à l’autre bout de la ville et il était impossible d’en percevoir le moindre son. Sans doute, pensa-t-elle, ce n’était qu’un rêve. Elle rêvait sans doute d’une insomnie se produisant dans son rêve. Elle se retourna dans ses draps. Le verre posé sur la table de nuit se mit pourtant à cliqueter. Ensuite, la vibration du verre s’étendit à la table de nuit puis au sol puis aux murs, et c’est toute la maison qui semblait prise de secousses comme dans un tremblement de terre. Elle se leva, et en deux enjambées atteignit la fenêtre. Un train, ou quoi que ce soit que ce fut, passait en ce moment même face à la maison. Cela ne faisait aucun doute. Cependant, paralysée par la peur, elle ne put ouvrir les rideaux. Quand la vibration cessa et le passage précipité des innombrables roues s’éteignit peu à peu, elle sentit le froid de la nuit gagner ses pieds et ses bras nus, reculant presque machinalement vers le lit. Le regard fixe porté sur la fenêtre, c’est comme si elle pouvait voir à travers les rideaux, comme si elle voyait encore ce qu’elle n’avait de toute façon pas pu voir.
Raul Vallejo, Deux whiskys secs et un mensonge
Elle regarde ses mains et c’est comme si elle se sentait morte. Ses ongles sont pâles sans le vernis qu’elle applique méticuleusement dessus un jour sur deux. Elle a aussi froid et il transpire. C’est un soulagement que tout soit fini. Dehors, il pleut rageusement et l’eau frappe bruyamment la vitre de la fenêtre. C’était mieux ainsi. Esteban étend sa vue vers le portail de la maison contre lequel une femme essaie de protéger de la pluie un enfant en son sein. Elle joue avec ses doigts en les croisant. Elle ne veut voir personne. Qu’il s’en aille, le mieux c’est qu’Esteban s’en aille, il vaut mieux rester seule. L’odeur de tabac se mélange au silence de la pièce et au murmure de la pluie. Dépourvu de choses, dépourvu de nom. Dormir pour qu’on me laisse seule. Sans hommes. Elle ferme les yeux et oublie sa pâleur et la stupeur d’Esteban. Si cela se produisait de nouveau dans les mêmes conditions, elle le referait.
Ressources portant sur la traduction de littérature et poésie :