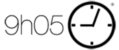Le poète en résidence
Katherine Dunn
Traduit de l’anglais (américain) par Benjamin Aguilar Laguierce (9h05 International)
À sa demande, je me cache sur le parking. Chaque fois que de la lumière s’approche par la route, je saute dans un arbre ou m’accroupis près d’une des froides voitures garées sur place. Il m’est plutôt égal que l’on me voie ou non, mais j’ai bien l’intention de surgir mystérieusement lorsqu’il arrivera en voiture. L’impressionner par ma discrétion, ma connaissance du subreptice. Mais la pluie met à mal cet effet. Je commence à m’énerver. Qui pourrait-il nous voir selon lui ? ou en avoir quelque chose à faire ? J’envisage de rentrer dans mon studio et de faire un écriteau pour les voitures qui passeraient : « J’ATTENDS DE ME TAPER M. LUCAS, LE POÈTE EN RÉSIDENCE ! ».
Mon mascara coule par-dessus les poches sous mes yeux. Je sens que la fine poudre boueuse sur mon front et mes joues commence à glisser.
Les lumières de la résidence universitaire et du réfectoire luisent sur la colline. Pas de formes alentour, rien que de la noirceur et l’obscurité d’une nuit sans lune qui me frappe et m’entoure. Une autre voiture quitte la route principale. Je me tiens derrière un arbre jusqu’à ce qu’elle disparaisse sur la longue allée de la fac. J’ai oublié de lui demander quelle voiture il conduit.
Le jeu d’espion perd de son attrait. Je me blottis sous l’arbre et m’imagine de retour dans mon lit avec un livre et un stock inépuisable de cigarettes. L’image de moi-même bien au chaud dans une bulle de fumée illuminée me fait de la peine.
J’aurais pu choisir un professeur moins paranoïaque. Mais ce professeur m’aurait-il choisie ? Heureusement, le poète en résidence ressent le devoir de caresser les étudiantes de première année, et je suis la seule andouille jusqu’à présent qui s’est montrée sensible à son ventre et sa poésie. Et il est le seul bêta qui soit sensible à moi. À moins qu’il ne se dégonfle et que je reste trempée toute la nuit. S’il n’est pas là quand la lune apparaitra, c’est décidé, je rentre.
Une lumière en provenance de la route tourne. Un mouvement de pistons syncopés. Une vieille Volkswagen haletante et grelottante entre sur le parking. Les phares pointent dans des directions opposées et des lunettes brillent à travers le pare-brise sombre. Je glisse hors de la protection de mon arbre en piétinant délicatement l’eau vers la voiture. Son visage gris et nerveux me renvoie un sourire. Je m’installe du côté passager et l’humidité envahit l’habitacle. Je claque la porte. Il tourne le volant avant d’élancer la voiture hors du parking, à travers l’allée puis sur la route, sans me lancer le moindre regard.
La première fois que je l’ai rencontré, je me souviens avoir pensé qu’il ressemblait à Ulysses S. Grant, à cause de ses cheveux noirs frisés, sa barbe noire frisée, ses épaisses lèvres roses et son front carré. Plus je le regardais, plus vraie semblait la ressemblance. La pluie entrecoupe la lumière émanant de l’éclairage public qui ondule sur son visage. Les veines qui s’étendent sur ses joues, les pores dépareillés sur la peau de son nez, ses yeux bleus comme l’eau, la faiblesse secrète de son menton. Il taille sa barbe pour qu’elle ressorte au lieu de glisser vers sa pomme d’Adam le long de son menton. Ses inquiétudes se regroupent sous forme de plis qui saillissent sur son front. À un feu rouge, il m’offre un large sourire fugace et coincé.
« Personne ne t’a vue ? Son regard se perd de nouveau sur la rue, mais je vois ses yeux qui glissent vers moi par saccades, dans l’attente de ma réponse.
« Personne d’autre que les pompiers et la mère de ta femme ».
Son petit rire tarde à venir. Ses grosses articulations des doigts semblent vert pâle avec la lumière en mouvement.
« Ça t’embêterait de te baisser sur ton siège jusqu’à ce qu’on soit sortis de la ville ? »
Sa bouche confuse. Le grincement de ma respiration. Je me laisse tomber sur le plancher et pose mon menton sur le siège. J’essaie d’éviter que mes bottes mouillées ne touchent mon derrière. Il y a d’étranges courants d’air ici-bas qui pénètrent le châssis, des coups de froid qui giclent sur mon dos et mes cheveux.
Il a l’air énorme. Ses écœurantes chaussures appuient et naviguent entre les pédales au bout de ses jambes sûres parées de laine. Une étoffe grise, tombant de ses bras, orne son ventre.
« Tu penses que je suis fou ? » me demande-t-il.
Ses grosses lèvres. Ses yeux implorants. Il aimerait mieux être chez lui, au lit, avec sa douce femme et une bouteille de bière. J’incline ma tête pour qu’il voie mon sourire dans l’obscurité sous le tableau de bord.
« Bien entendu, tu es lunatique ».
Il est satisfait. Il est extrêmement important d’être fou quand on est poète. Il porte sa main à sa poche de poitrine. « J’ai quelque chose pour toi ».
Un paquet de petits cigares.
« Ça ne t’embête pas ? Avec ton asthme ? J’avais pas l’intention de fumer du tout ». Je me suis préparée à me montrer rude pendant deux jours.
« Non. La fumée des cigares ne me gêne pas. Je peux même en fumer. Il n’y a qu’avec les cigarettes que je m’étouffe ».
On s’assoit dans sa classe toutes fenêtres ouvertes, avec la pluie qui s’y engouffre. Personne n’enlève pas son manteau. Il porte toujours le même costume. On dirait qu’il a emmagasiné des patates dans ses poches pendant plusieurs saisons. La même chemise en flanelle aux motifs écossais par-dessus d’improbables couches de sous-vêtements, ou peut-être cette mollesse est-elle sa chair qui remonte sous ses vêtements. La cravate aux motifs écossais détonants est toujours tellement de travers qu’elle laisse passer les poils raides de sa poitrine à travers le col.
« Tu as mangé ce soir ? Moi non. Ça te dit un hamburger ? »
« Super ! » dis-je allègrement.
Injecter un peu d’énergie dans le sourire, un peu plus que d’habitude, à vrai dire en raison de l’obscurité en dessous du tableau de bord. Le moteur s’étouffe. Il retire la clef et regarde alentour, ses yeux reflètent la lumière. Il baisse alors son regard pour me sourire et s’éclipse. Il s’incline un moment avant de claquer la portière.
« Reste cachée un petit peu plus. Beaucoup d’étudiants viennent ici ».
Son visage anxieux disparait dans un éclair spectaculaire. Je relève ma tête par-dessus le niveau de la fenêtre et vois son derrière avachi trotter sur le goudron luisant. L’immense bouche sur l’enseigne lumineuse s’apprête à avaler une olive irrésistiblement charnue et un piment orienté avec obscénité. Il m’a laissée seule au fin fond obscur du parking. Vais-je vraiment m’apitoyer sur mon sort, me laisser abattre, pinailler et soupirer pour ce personnage ? Oui. Que d’ennui n’ai-je au nom de l’excitation. Je le vois à travers la fenêtre du café alors qu’il jette de furtifs coups d’œil à l’accumulation disparate de clients, qu’il marmonne sa commande à la serveuse de telle sorte qu’aucun maître-chanteur ou mouchard ne puisse l’entendre demander deux cafés, deux hamburgers et deux portions de frites.
Au moment où il revient à la voiture, je glousse. Il me tend les cafés couronnés de couvercles. Je les mets en équilibre au-dessus du siège pendant qu’il s’installe.
« Je suis désolé pour tout ça. Tu peux te relever maintenant ».
Mes fesses sont engourdis et mes jambes me font mal. Le froid a pénétré mes reins et provoqué une réaction. Je me tire sur le siège et ouvre le café. Je pose les couvercles sur l’appui-coude. Je déchire le papier chaud et gras qui entoure la nourriture.
« J’espère que tu aimes les ognons ».
« Tu as dit quoi à ta femme ? »
Je lui tends un hamburger, étale un sachet de ketchup sur les pommes de terre. Il mastique et mâche. « Un week-end de conférence avec un éditeur ».
L’obscurité se met en mouvement, pâli et disparait dans plus d’obscurité encore. Pas de voitures. Pas de lumières. La route grise qui tournoie derrière nous. Les phares attrapent momentanément les formes. Je ne lui demanderai pas si elle l’a cru. Ce serait ouvrir la voie à trop de méchanceté. Soit il se montrerait satisfait et dirait n’en avoir rien à faire, soit il me dirait absolument tout sur elle.
La rivière est grise comme la mort à côté de nous. Une petite lumière désagréable apparait brièvement de l’autre côté. Il vaut mieux être poétique pour lui. Le défaire de toute pensée liée aux répercussions.
« Je descendais souvent ici l’été dernier pour pêcher » lui dis-je. « J’apportais du maïs en conserve et du poisson pour les carpes, là, vers les moulins à farine, tôt le matin. Le matin se levait et adoucissait les quais et les ponts, inondant le tout de sa lumière bleu lavande. Je sortais alors le gros poisson doré de l’eau pourpre et les écailles atterrissaient sur mes ongles comme de la poudre d’or ».
Je regarde la rivière et sent son sourire.
« Tu devrais vraiment écrire de la poésie » dit-il.
Il plonge une main à l’aveugle dans les frites et la fourre dans sa bouche. Il essuie le gras sur la laine de son pantalon et attrape son café. Je le regarde comme si j’étais légèrement surprise. Je mords, songeuse, dans mon hamburger et mâche jusqu’à ce que la tomate ballante réussisse à entrer dans ma bouche.
« Oh, je crois que la poésie exige des types de sentiments qui diffèrent de ceux que j’ai ».
C’est une promenade de santé pour lui. Il affiche un large sourire bouffi et glisse vers moi dans un ordinaire frétillement nonchalant de la tête.
« Une poète » dit-il. Il fait de cette légèreté sonore une évidence. Nous sommes vraiment tous de mauvais acteurs. « Un poète est un homme qui court tout nu au milieu de tous les orages espérant se prendre un coup de tonnerre ».
Il pousse le hamburger dans sa bouche et avance sa joue bien remplie vers moi. Très sûr de lui. Des citations dignes d’être citées. La pluie s’étale. Il n’y a pas de gouttes, rien que le mouvement constant d’un mur d’eau et, face aux phares, une avalanche de cordes. C’est mon tour maintenant. Il attend et mâche.
« Je parie que c’est moi l’orage de cette semaine ».
« Non, ma chère, le tonnerre. Le tonnerre ».
J’étais trop prévisible. Il s’y attendait. Je le regarde. Il me regarde. Il me renvoie un intense sourire destiné à me convaincre de mes qualités électriques.
Je serais incapable d’être putain de profession. Pas longtemps, en tout cas. Ce serait du travail bien trop dur. Mais l’argent peut rendre la chose intéressante. C’est suffisant pour une durée de vie moyenne de casser un homme, d’établir le comportement que l’on a choisi pour soi, de suivre la trace de ses susceptibilités et d’analyser ses ruses, mais devoir endurer ça encore et encore (se sentir à la recherche de points faibles, mettre minutieusement le doigt sur les orgueils, les exploiter et s’en moquer) des centaines ou de milliers de fois ? et ne pas pouvoir choisir ? Ce n’est pas que j’ai beaucoup de choix en l’état. Ma paye s’envole dans des mauvais hamburgers et des week-ends dans des hôtels bas de gamme, mais au moins je peux aller chez moi et récupérer jusqu’à ce que ma fébrilité me remette au travail.
Mais tout va bien, maintenant. À chaque sourire, il reprend un peu de son peps, pense un peu moins à se faire prendre et un peu plus à ses fantasmes.
Sa main glisse sur mon genou et le serre. Je glisse un bras le long du dos du siège et passe mes doigts dans ses cheveux. Le toucher est celui d’un bout de tissu d’ameublement à bas prix.
« Tu dois être fatigué » lui dis-je. « Tu sera épuisé quand on arrivera à la côte ».
Je sens la bosse osseuse derrière ses oreilles.
« Non » répond-il. « Je suis chaud comme la braise ».
Pauvre mec qui essaie de s’exciter. Il tire ma main vers sa cuisse. C’est vrai, j’ai toujours eu une faiblesse pour la délicatesse des cuisses. Comme l’intérieur des jambes des chevaux, l’incroyable douceur du dos d’un chien, ventre et couilles dénudées en signe de soumission. Mais il doit y avoir une forme sur laquelle reposer la délicatesse. Cette cuisse est un entremets. Un entremets avec un os. La cuillère, peut-être.
Il rétrograde pour prendre un virage. On grimpe, maintenant. La rivière est partie. Des collines et des arbres. Des stations essence isolées dans une lueur douloureuse. Sa main retombe contre la mienne et l’attire vers son entrejambe. Sérieux ? On va vraiment devoir faire ça ? Alors qu’il nous reste encore une bonne heure de route ?
Je fouille consciencieusement à la recherche de son bijou recouvert de laine. Son ventre me barre la route. Où est donc son machin ? Des boutons et une braguette et de la laine par-dessus le bijou. La main sur la mienne s’élève, entoure ma tête puis essaie de me tirer vers le bas. A-t-il eu des fantasmes à ce sujet ? Ou pense-t-il qu’il s’agit d’une partie obligatoire du programme ? Il a dû libérer ma tête pour changer de nouveau de vitesse. La voiture fonce sur la route étroite que l’on croirait blanche du fait des lumières. Sa main revient et attire encore ma tête vers le bas. Si je dois m’allonger sur le levier de vitesse pour le sucer, ça va être pitoyable dans cette étroitesse. Je devrais le faire de travers ce qui me donnerait un point de côté. Et je ferais quoi avec mon bras droit ? Le caler entre les sièges ? Non. J’attendrai qu’on arrive au motel. Il a déjà épuisé tout ma capacité de résistance à l’inconfort en allant acheter un hamburger. Je fais un rire doux. Je caresse son oreille du nez faire passer la situation. Il a de petits poils dans les oreilles.
« Attendons un peu. Imagine qu’il y a un trou sur la route et que je te le coupe en deux ».
Son rire tranchant est presque naturel de surprise. Il plisse les yeux vers la route. Il va faire la tronche un moment. Je donne une dernière petite tape à son bijou et me détends de nouveau sur le siège. Je déchire le paquet de cigares. Je renifle ostensiblement les bouts de plastique pour ne pas le laisser croire que je suis emportée par leur qualité.
« Tu en veux un ? »
Il me lance un sourire résigné. « Oui, pourquoi pas ».
Je les allume un à un. L’odeur nauséabonde me percute le nez avant que je ne puisse me remplir les poumons. Je tousse. Une fois pénétrée entièrement par cette odeur, je ne la sens même plus. Il tient le sien comme on tient un crayon et le prend délicatement une taffe, emplissant sa bouche puis expulsant la fumée.
« Pourquoi crois-tu que les cigares ne te font pas de mal avec ton asthme ? ».
Tout est revenu à la normale. Il me raconte en long et en large que son asthme est une condition purement psychologique qu’il a contractée spontanément, quand, âgé de trente-six ans, il a lu son premier article sur la pollution de l’air dans la salle d’attente de l’hôpital où sa mère était en train de mourir d’un cancer du col de l’utérus.
Il est donc soulagé, lui aussi. Il ne voulait pas vraiment que je lui suce la queue pendant qu’il changeait les vitesses, jouait des pédales et maniait le volant d’une caisse à savon sur une route mouillée au milieu de la nuit après avoir travaillé toute la journée sans même avoir pris de douche, comploté contre sa femme et craint d’être découvert.
Maintenant que j’y pense, c’était la première fois qu’on se touchait. Tout n’était que flirt verbal au début, je l’assume, parce qu’aucun de nous ne trouvait l’autre attirant. Nous nous retrouvons ici conformément à nos principes distincts.
Lui avait été marié deux fois et avait publié un livre de poèmes, il avait laissé pousser sa barbe et refusé de tondre sa pelouse, il avait réussi à transformer une page d’une revue de gauche en une maladie chronique, il avait adopté toutes les manières de déambuler sans couvre-chef sous la pluie dans l’espoir qu’on le reconnaisse et qu’on dise qui il était, qu’il devait continuer à esquisser son propre portrait et finir le tableau.
Et moi, Sally, envers qui mes camarades meuglaient, moi qui rasais les murs et m’installais la nuit à la recherche de blagues dans Reader’s Digestpour les placer dans mes conversations le lendemain, moi qui avais été trop longtemps involontairement gentille, j’exploitais des ressources que je ne me soupçonnais pas dans mon projet actuel. Je me suis frayé mon chemin à travers crétins réticents et accros au soda, peintres en herbe, un bon pianiste qui étudiait pour devenir un mauvais psychologue, un vendeur ambulant de jonquilles, et, maintenant, ici, ce soir, je cherchais, sans l’avoir précisément localisée, la queue du poète en résidence. Peut-être écrira-t-il un poème à ma gloire, ou peut-être me donnera-t-il une bonne note en anglais. Les peintres ont fait des portraits de moi, même si ce n’était que des croquis au pastel, suffisants pour un coup du soir. Je les ai entassés dans le tiroir gauche de mon bureau, séparés entre eux par du papier de soie. Le pianiste, qui était vierge jsuqu’à ce qu’il fasse appel à moi, a écrit une mélodie et l’a jouée pour moi dans la chapelle. Un mauvais poème irait très bien dans ma collection.
(À suivre…)